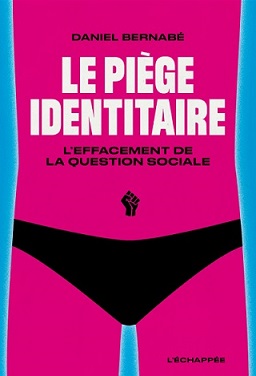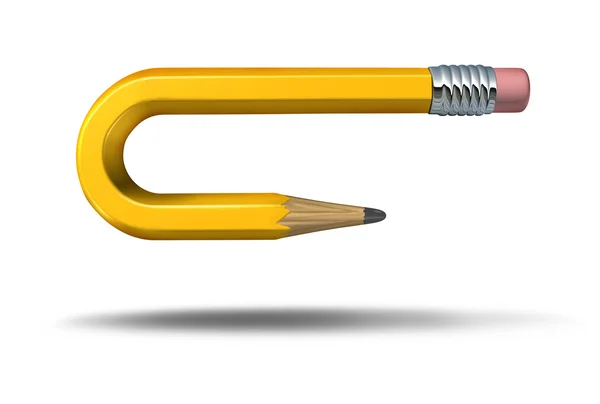13 septembre 2022
Pour faire face à la menace russe imaginaire qui pèse sur l’Europe
occidentale, l’Allemagne prendra la tête d’une UE élargie et
militarisée.
Le spectre de l’Allemagne se lève (Consortium News)
Olaf Scholz, chancelier fédéral d’Allemagne, rencontre Volodymyr Zelenskyy, président de l’Ukraine, à Kiev, le 14 février 2022.
L’Union
européenne se prépare à une longue guerre contre la Russie qui semble
clairement contraire aux intérêts économiques et à la stabilité sociale
de l’Europe. Une guerre apparemment irrationnelle - comme beaucoup le
sont - a des racines émotionnelles profondes et revendique une
justification idéologique. Il est difficile de mettre fin à de telles
guerres parce qu’elles sortent du cadre de la rationalité.
Pendant
des décennies après l’entrée de l’Union soviétique à Berlin et la
défaite décisive du Troisième Reich, les dirigeants soviétiques se sont
inquiétés de la menace du "revanchisme allemand". Puisque la Seconde
Guerre mondiale pouvait être considérée comme une revanche allemande
pour avoir été privée de la victoire lors de la Première Guerre
mondiale, l’agressivité allemande Drang nach Osten ne
pouvait-elle pas être ravivée, surtout si elle bénéficiait du soutien
anglo-américain ? Il y a toujours eu une minorité dans les cercles de
pouvoir américains et britanniques qui aurait voulu achever la guerre
d’Hitler contre l’Union soviétique.
Ce n’était pas le désir de
répandre le communisme, mais le besoin d’une zone tampon pour faire
obstacle à de tels dangers qui constituait la principale motivation de
la répression politique et militaire soviétique permanente sur
l’ensemble des pays, de la Pologne à la Bulgarie, que l’Armée rouge
avait arrachés à l’occupation nazie.
Cette préoccupation s’est
considérablement atténuée au début des années 1980, lorsqu’une jeune
génération allemande est descendue dans la rue pour manifester
pacifiquement contre le stationnement d’"euromissiles" nucléaires qui
pourraient accroître le risque de guerre nucléaire sur le sol allemand.
Ce mouvement a créé l’image d’une nouvelle Allemagne pacifique. Je crois
que Mikhaïl Gorbatchev a pris cette transformation au sérieux.
Le
15 juin 1989, Gorbatchev est venu à Bonn, qui était alors la modeste
capitale d’une Allemagne de l’Ouest faussement modeste. Apparemment ravi
de l’accueil chaleureux et amical, Gorbatchev s’est arrêté pour serrer
les mains tout au long du chemin dans cette ville universitaire paisible
qui avait été le théâtre de grandes manifestations pacifistes.
J’étais
là et j’ai pu constater sa poignée de main inhabituellement chaleureuse
et ferme et son sourire enthousiaste. Je ne doute pas que Gorbatchev
croyait sincèrement en une "maison européenne commune" où l’Europe de
l’Est et l’Europe de l’Ouest pourraient vivre en harmonie côte à côte,
unies par une sorte de socialisme démocratique.
Gorbatchev est
mort à l’âge de 91 ans il y a deux semaines, le 30 août. Son rêve de
voir la Russie et l’Allemagne vivre heureuses dans leur "maison
européenne commune" a rapidement été mis à mal par le feu vert donné par
l’administration Clinton à l’expansion de l’OTAN vers l’est. Mais la
veille de la mort de Gorbatchev, d’éminents politiciens allemands réunis
à Prague ont anéanti tout espoir d’une telle fin heureuse en proclamant
leur volonté de diriger une Europe vouée à la lutte contre l’ennemi
russe.
Il s’agissait d’hommes politiques issus des mêmes partis -
le SPD (parti social-démocrate) et les Verts - qui avaient pris la tête
du mouvement pacifiste des années 1980.
L’Europe allemande doit s’étendre vers l’Est
Le
chancelier allemand Olaf Scholz est un politicien SPD incolore, mais
son discours du 29 août à Prague était incendiaire dans ses
implications. Scholz a appelé à une Union européenne élargie et
militarisée sous la direction de l’Allemagne. Il a affirmé que
l’opération russe en Ukraine soulevait la question de savoir "où sera la
ligne de démarcation à l’avenir entre cette Europe libre et une
autocratie néo-impériale". Nous ne pouvons pas nous contenter de
regarder, a-t-il dit, "des pays libres être rayés de la carte et
disparaître derrière des murs ou des rideaux de fer."
(Note : le
conflit en Ukraine est clairement l’affaire inachevée de l’effondrement
de l’Union soviétique, aggravée par une provocation extérieure
malveillante. Comme pendant la guerre froide, les réactions défensives
de Moscou sont interprétées comme des signes avant-coureurs d’une
invasion russe en Europe, et donc comme un prétexte à l’accumulation
d’armes).
Pour répondre à cette menace imaginaire, l’Allemagne
prendra la tête d’une UE élargie et militarisée. Tout d’abord, Scholz a
déclaré à son auditoire européen dans la capitale tchèque : "Je m’engage
à élargir l’Union européenne aux États des Balkans occidentaux, à
l’Ukraine, à la Moldavie et, à long terme, à la Géorgie". Il est un peu
étrange de s’inquiéter du déplacement de la ligne de démarcation vers
l’ouest par la Russie alors que l’on prévoit d’intégrer trois anciens
États soviétiques, dont l’un (la Géorgie) est géographiquement et
culturellement très éloigné de l’Europe mais aux portes de la Russie.
Dans
les "Balkans occidentaux", l’Albanie et quatre petits États extrêmement
faibles issus de l’ex-Yougoslavie (Macédoine du Nord, Monténégro,
Bosnie-Herzégovine et Kosovo largement non reconnu) produisent
principalement des émigrants et sont loin des normes économiques et
sociales de l’UE. Le Kosovo et la Bosnie sont des protectorats de facto
de l’OTAN, occupés militairement. La Serbie, plus solide que les autres,
ne montre aucun signe de renoncement à ses relations bénéfiques avec la
Russie et la Chine, et l’enthousiasme populaire pour "l’Europe" parmi
les Serbes s’est estompé.
L’ajout de ces États membres permettra
de réaliser "une Union européenne plus forte, plus souveraine et plus
géopolitique", a déclaré M. Scholz. Une "Allemagne plus géopolitique",
plutôt. Alors que l’UE s’élargit vers l’est, l’Allemagne se trouve "au
centre" et fera tout pour les rassembler. Ainsi, outre l’élargissement,
M. Scholz appelle à "un passage progressif aux décisions à la majorité
en matière de politique étrangère commune" pour remplacer l’unanimité
requise aujourd’hui.
Ce que cela signifie devrait être évident
pour les Français. Historiquement, les Français ont défendu la règle du
consensus afin de ne pas être entraînés dans une politique étrangère
dont ils ne veulent pas. Les dirigeants français ont exalté le mythique
"couple franco-allemand" comme garant de l’harmonie européenne,
principalement pour garder les ambitions allemandes sous contrôle.
Mais
Scholz dit qu’il ne veut pas d’une "UE d’États ou de directorats
exclusifs", ce qui implique le divorce définitif de ce "couple". Avec
une UE de 30 ou 36 États, note-t-il, "une action rapide et pragmatique
est nécessaire." Et il peut être sûr que l’influence allemande sur la
plupart de ces nouveaux États membres pauvres, endettés et souvent
corrompus produira la majorité nécessaire.
La France a toujours
espéré une force de sécurité européenne distincte de l’OTAN, dans
laquelle les militaires français joueraient un rôle de premier plan.
Mais l’Allemagne a d’autres idées. "L’OTAN reste le garant de notre
sécurité", a déclaré Scholz, se réjouissant que le président Biden soit
"un transatlantiste convaincu".
"Chaque amélioration, chaque
unification des structures de défense européennes dans le cadre de l’UE
renforce l’OTAN", a déclaré Scholz. "Avec d’autres partenaires de l’UE,
l’Allemagne veillera donc à ce que la force de réaction rapide prévue
par l’UE soit opérationnelle en 2025 et fournira alors également son
noyau.
Cela nécessite une structure de commandement claire.
L’Allemagne assumera cette responsabilité "lorsque nous dirigerons la
force de réaction rapide en 2025", a déclaré M. Scholz. Il a déjà été
décidé que l’Allemagne soutiendrait la Lituanie avec une brigade
rapidement déployable et l’OTAN avec d’autres forces en état de
préparation élevé.
Servir pour diriger ... où ?
En
bref, le renforcement militaire de l’Allemagne donnera corps à la
fameuse déclaration de Robert Habeck à Washington en mars dernier :
"Plus l’Allemagne servira avec force, plus son rôle sera grand". Habeck,
le Vert, est le ministre allemand de l’économie et la deuxième
personnalité la plus puissante du gouvernement allemand actuel.
La
remarque a été bien comprise à Washington : en servant l’empire
occidental dirigé par les États-Unis, l’Allemagne renforce son rôle de
leader européen. De la même manière que les États-Unis arment,
entraînent et occupent l’Allemagne, celle-ci fournira les mêmes services
aux petits États de l’UE, notamment à l’est.
Depuis le début de
l’opération russe en Ukraine, la politicienne allemande Ursula von der
Leyen a profité de sa position à la tête de la Commission européenne
pour imposer des sanctions toujours plus drastiques à la Russie, ce qui a
fait planer la menace d’une grave crise énergétique européenne cet
hiver. Son hostilité envers la Russie semble sans limite. En avril
dernier, à Kiev, elle a appelé à une adhésion rapide à l’UE de
l’Ukraine, qui est notoirement le pays le plus corrompu d’Europe et qui
est loin de respecter les normes européennes. Elle a proclamé que "la
Russie va sombrer dans la déchéance économique, financière et
technologique, tandis que l’Ukraine marche vers un avenir européen."
Pour Mme von der Leyen, l’Ukraine "mène notre guerre". Tout cela va bien
au-delà de son autorité pour parler au nom des 27 membres de l’UE, mais
personne ne l’arrête.
Annalena Baerbock, ministre des affaires
étrangères des Verts allemands, est tout aussi déterminée à "ruiner la
Russie". Partisane d’une "politique étrangère féministe", Baerbock
exprime sa politique en termes personnels. "Si je fais la promesse aux
gens en Ukraine, nous sommes à vos côtés aussi longtemps que vous avez
besoin de nous", a-t-elle déclaré en anglais lors du Forum 2000 à
Prague, parrainé par le National Endowment for Democracy (NED)
des États-Unis, le 31 août. "Alors je veux tenir mes promesses, peu
importe ce que pensent mes électeurs allemands, mais je veux tenir mes
promesses au peuple ukrainien".
"Les gens iront dans la rue et
diront, nous ne pouvons pas payer nos prix de l’énergie, et je dirai,
’Oui je sais donc nous allons vous aider avec des mesures sociales.
[...] Nous serons aux côtés de l’Ukraine et cela signifie que les
sanctions resteront en vigueur jusqu’à l’hiver, même si cela devient
très difficile pour les politiciens".
Certes, le soutien à
l’Ukraine est fort en Allemagne, mais peut-être en raison de la pénurie
d’énergie qui se profile, un récent sondage Forsa indique que quelque
77 % des Allemands seraient favorables à des efforts diplomatiques pour
mettre fin à la guerre - ce qui devrait être l’affaire du ministre des
affaires étrangères. Mais Baerbock ne montre aucun intérêt pour la
diplomatie, seulement pour un "échec stratégique" pour la Russie - quel
que soit le temps que cela prendra.
Dans le mouvement pacifiste
des années 1980, une génération d’Allemands prenait ses distances avec
celle de leurs parents et jurait de surmonter les "représentations de
l’ennemi " héritées des guerres passées. Curieusement, Baerbock, née en
1980, a fait référence à son grand-père qui a combattu dans la Wehrmacht
comme ayant en quelque sorte contribué à l’unité européenne. Est-ce là
le pendule générationnel ?
Les petits revanchards
Il
y a lieu de supposer que la russophobie allemande actuelle tire une
grande partie de sa légitimation de la russophobie des anciens alliés
nazis dans les petits pays européens.
Si le revanchisme anti-russe
allemand a peut-être mis deux générations à s’affirmer, un certain
nombre de revanchismes plus petits et plus obscurs ont fleuri à la fin
de la guerre européenne et ont été intégrés dans les opérations de
guerre froide des États-Unis. Ces petits revanchismes n’ont pas été
soumis aux mesures de dénazification ou à la culpabilité de l’Holocauste
imposées à l’Allemagne. Au contraire, ils ont été accueillis par la
C.I.A., Radio Free Europe et les commissions du Congrès pour leur
anticommunisme fervent. Ils ont été renforcés politiquement aux
Etats-Unis par les diasporas anticommunistes d’Europe de l’Est.
Parmi
celles-ci, la diaspora ukrainienne est certainement la plus importante,
la plus intensément politique et la plus influente, tant au Canada que
dans le Middle West américain. Les fascistes ukrainiens qui
avaient auparavant collaboré avec les envahisseurs nazis étaient les
plus nombreux et les plus actifs, dirigeant le Bloc des nations
antibolcheviques qui avait des liens avec les services de renseignements
allemands, britanniques et américains.
La Galicie d’Europe
orientale, à ne pas confondre avec la Galicie espagnole, a fait partie
de la Russie et de la Pologne pendant des siècles. Après la Seconde
Guerre mondiale, elle a été divisée entre la Pologne et l’Ukraine. La
Galicie ukrainienne est le centre d’un nationalisme ukrainien virulent,
dont le principal héros de la Seconde Guerre mondiale est Stepan
Bandera. Ce nationalisme peut être qualifié à juste titre de "fasciste",
non pas simplement en raison de signes superficiels - ses symboles, ses
saluts ou ses tatouages - mais parce qu’il a toujours été
fondamentalement raciste et violent.
Incité par les puissances
occidentales, la Pologne, la Lituanie et l’Empire des Habsbourg, la clé
du nationalisme ukrainien était qu’il était occidental, et donc
supérieur. Les Ukrainiens et les Russes étant issus de la même
population, l’ultra-nationalisme ukrainien pro-occidental s’est
construit sur des mythes imaginaires de différences raciales : Les
Ukrainiens faisaient partie du véritable Occident, quoi que cela
signifie, tandis que les Russes étaient métissés avec des "Mongols" et
constituaient donc une race inférieure. Les nationalistes ukrainiens
banderistes ont ouvertement appelé à l’élimination des Russes en tant
que tels, en tant qu’êtres inférieurs.
Tant que l’Union soviétique
existait, la haine raciale des Ukrainiens envers les Russes avait pour
couverture l’anticommunisme, et les agences de renseignement
occidentales pouvaient les soutenir sur la base de l’idéologie "pure" de
la lutte contre le bolchevisme et le communisme. Mais maintenant que la
Russie n’est plus dirigée par des communistes, le masque est tombé, et
la nature raciste de l’ultranationalisme ukrainien est visible - pour
tous ceux qui veulent la voir.
Cependant, les dirigeants et les médias occidentaux sont déterminés à ne pas le remarquer.
L’Ukraine
n’est pas un pays occidental comme les autres. Elle est profondément et
dramatiquement divisée entre le Donbass à l’Est, des territoires russes
donnés à l’Ukraine par l’Union soviétique, et l’Ouest anti-russe, où se
trouve la Galacie. La défense du Donbass par la Russie, qu’elle soit
sage ou non, n’indique en aucun cas une intention russe d’envahir
d’autres pays. Cette fausse alerte est le prétexte à la remilitarisation
de l’Allemagne en alliance avec les puissances anglo-saxonnes contre la
Russie.
Le prélude yougoslave
Ce processus a commencé dans les années 1990, avec l’éclatement de la Yougoslavie.
La
Yougoslavie n’était pas un membre du bloc soviétique. C’est précisément
pour cette raison que le pays a obtenu des prêts de l’Occident qui,
dans les années 1970, ont conduit à une crise de la dette dans laquelle
les dirigeants de chacune des six républiques fédérées ont voulu refiler
la dette aux autres. Cette situation a favorisé les tendances
séparatistes dans les républiques slovène et croate, relativement
riches, tendances renforcées par le chauvinisme ethnique et les
encouragements des puissances extérieures, notamment de l’Allemagne.
Pendant
la Seconde Guerre mondiale, l’occupation allemande avait divisé le
pays. La Serbie, alliée de la France et de la Grande-Bretagne lors de la
Première Guerre mondiale, a été soumise à une occupation punitive. La
Slovénie idyllique a été absorbée par le Troisième Reich, tandis que
l’Allemagne soutenait une Croatie indépendante, dirigée par le parti
fasciste Oustachi, qui comprenait la majeure partie de la Bosnie,
théâtre des combats internes les plus sanglants. À la fin de la guerre,
de nombreux oustachis croates ont émigré en Allemagne, aux États-Unis et
au Canada, sans jamais abandonner l’espoir de raviver le nationalisme
croate sécessionniste.
À Washington, dans les années 1990, les
membres du Congrès ont obtenu leurs impressions sur la Yougoslavie
auprès d’un seul expert : Mira Baratta, une Américaine d’origine croate
de 35 ans, assistante du sénateur Bob Dole (candidat républicain à la
présidence en 1996). Le grand-père de Baratta avait été un important
officier de l’Oustachi en Bosnie et son père était actif au sein de la
diaspora croate en Californie. Baratta a rallié non seulement Dole mais
aussi la quasi-totalité du Congrès à la version croate des conflits
yougoslaves rejetant tout sur les Serbes.
En Europe, les Allemands
et les Autrichiens, notamment Otto von Habsburg, héritier du défunt
Empire austro-hongrois et député européen de Bavière, ont réussi à
présenter les Serbes comme les méchants, prenant ainsi une revanche
efficace contre leur ennemi historique de la Première Guerre mondiale,
la Serbie. En Occident, il est devenu habituel d’identifier la Serbie
comme "l’allié historique de la Russie", oubliant que dans l’histoire
récente, les plus proches alliés de la Serbie étaient la Grande-Bretagne
et surtout la France.
En septembre 1991, un politicien
chrétien-démocrate et avocat constitutionnel allemand de premier plan a
expliqué pourquoi l’Allemagne devrait favoriser l’éclatement de la
Yougoslavie en reconnaissant les républiques yougoslaves sécessionnistes
slovène et croate. (Rupert Scholz, ancien ministre de la défense de la
CDU, lors du 6e symposium Fürstenfeldbrucker pour la direction de
l’armée et des affaires allemandes, qui s’est tenu les 23 et 24
septembre 1991).
En mettant fin à la division de l’Allemagne,
Rupert Scholz a déclaré : "Nous avons, pour ainsi dire, surmonté et
maîtrisé les conséquences les plus importantes de la Seconde Guerre
mondiale... mais dans d’autres domaines, nous sommes toujours confrontés
aux conséquences de la Première Guerre mondiale" - qui, a-t-il noté, "a
commencé en Serbie."
"La Yougoslavie, conséquence de la Première
Guerre mondiale, est une construction très artificielle, jamais
compatible avec l’idée d’autodétermination", a déclaré Rupert Scholz. Il
conclut : "A mon avis, la Slovénie et la Croatie doivent être
immédiatement reconnues au niveau international. (...) Lorsque cette
reconnaissance aura eu lieu, le conflit yougoslave ne sera plus un
problème interne à la Yougoslavie, où aucune intervention internationale
ne peut être autorisée."
Et en effet, la reconnaissance a été
suivie d’une intervention occidentale massive qui se poursuit encore
aujourd’hui. En prenant parti, l’Allemagne, les États-Unis et l’OTAN ont
finalement produit un résultat désastreux, une demi-douzaine d’îlots
étatiques, avec de nombreux problèmes non résolus et fortement
dépendants des puissances occidentales. La Bosnie-Herzégovine est sous
occupation militaire ainsi que sous le diktat d’un "Haut représentant"
qui se trouve être allemand. Elle a perdu environ la moitié de sa
population à cause de l’émigration.
Seule la Serbie montre des
signes d’indépendance, refusant de se joindre aux sanctions occidentales
contre la Russie, malgré de fortes pressions. Pour les stratèges de
Washington, l’éclatement de la Yougoslavie était un exercice
d’utilisation des divisions ethniques pour briser des entités plus
grandes, l’URSS puis la Russie.
Bombardements humanitaires...
Lire la suite



.jpg)